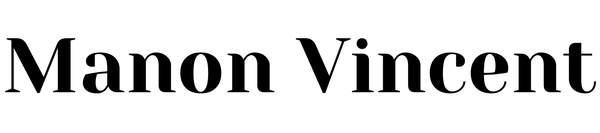Les cloches de la cathédrale Saint-Vincent sonnent 9h30 quand j’arrive devant le Majorelle. J’aperçois Anna et quelques minutes plus tard, Mohammad nous rejoint sur son vélo bleu ciel, assorti à sa chemise. Il arrive de la gare. Il est venu en train depuis Dijon où il vit désormais avec sa femme et ses trois jeunes enfants.
Note : cette interview a été menée dans le cadre de la réalisation de la revue interculturelle Voix Du Monde, en partenariat avec le CICFM.
Mohammad : reporter engagé en Afghanistan
Mohammad a 35 ans et vient d’Afghanistan. Il a étudié le journalisme à l’Université de Kaboul. À la fin de ses études, en 2014, il travaille pour une chaîne de télévision où il réalise des reportages. « J’abordais des sujets…» Il s’interrompt lui-même avec un sourire, « j’abordais, non, c’est bien ça ? », cherchant confirmation de la bonne utilisation de ce mot. Anna lui confirme avec un sourire. « J’abordais des sujets comme la sécurité. C’était un sujet important car notre pays était en guerre, et plus de 40 pays avaient leur armée là-bas, mais aussi des sujets sur le quotidien de la société et puis la condition des femmes. »
Il poursuit sur ce dernier point.
« On a beaucoup de sujets et de défis autour de la femme en Afghanistan. Leur sécurité, leur accès à l’éducation, à la culture et au travail. L’expression des femmes, ce n’est pas comme ici. En France, c’est le même regard. En Afghanistan, les femmes doivent rester de côté, isolées. »
Mohammad était un reporter engagé politiquement, pour la défense de la démocratie et de la liberté. Il a également travaillé pour le service presse du Parlement Afghan, puis a été responsable médias et chargé de communication de la société de chemins de fers du pays. Il est très attaché au service public.

Mohammad avec Markus Potzel, représentant spécial adjoint de l’ONU pour l’Afghanistan. Cette photo a été prise après un interview avec lui en 2015.
Quand Kaboul tombe, sa vie bascule
En Août 2021, les Talibans attaquent Kaboul et reprennent le pouvoir. La situation de Mohammad devient très compliquée. « C’était très risqué, je devais me cacher. ». Son engagement contre ces groupes terroristes et leur idéologie, sa défense de la démocratie et de la liberté en font un ennemi et une cible. Il reçoit des menaces de mort et nous confie :
« Il y a beaucoup de personnes comme moi qui ont été tuées ».
L’exil forcé : quitter une terre où l’on est devenu ennemi
En Octobre 2021, sa dernière fille vient de naître, mais le danger est de plus en plus grand. Il fuit au Pakistan, seul. À Islamabad, une personne de Reporters Sans Frontières l’aide pour faire une demande de Visa d’asile pour lui et sa famille, auprès de l’ambassade de France et d’Allemagne. Trois mois plus tard, il obtient un entretien à l’ambassade de France « On m’a dit qu’il y avait une possibilité. Peut-être que votre dossier sera accepté. Peut-être pas. ». Après plus de six mois d’incertitudes, il obtient finalement un visa. Sa femme le rejoint avec leurs enfants au Pakistan avant de partir pour la France.
Les premières semaines en France
Nous sommes le 12 décembre 2022 quand Mohammad et sa famille quittent le Pakistan. Deux vols, Islamabad-Oman puis Oman-Paris les mènent à la capitale. À Paris, ils sont accueillis par une journaliste que Mohammad avait connue via les réseaux sociaux. Ils y restent 10 jours, le temps de mettre en place les premières démarches. Mohammad se souvient, avec un trait d’humour, de l’un de ses premiers trajets : « En Afghanistan et au Pakistan, les transports, c'est simple. À Paris, quand j’ai dû prendre le métro pour aller à la préfecture, j’étais un peu perdu. Ligne 1, ligne 2, ligne 3… » il poursuit : « Mais quand j’étais perdu et que j’ai posé des questions, les personnes m’ont guidé. Certaines m’ont même accompagné ».
Mohammad n’était jamais venu en France avant, mais grâce à son métier de journaliste et aux réseaux sociaux, il connaissait un peu le pays. Le français, il en avait quelques bases grâce au lycée et il connaissait déjà un peu la culture grâce à un lieu bien particulier « À Kaboul je passais beaucoup de temps dans le Centre Culturel Français. C’est un très bel appartement (je pense que Mohammad voulait dire endroit) Il y a des artistes, des peintres et des cinéastes.» Néanmoins, il nous confie « Pendant deux, trois mois, toutes les choses étaient nouvelles pour moi. Et encore plus pour mon épouse ! »
L’apprentissage du français : vecteur d’intégration et d’insertion
Les autorités françaises redirigent Mohammad et sa famille vers la ville de Chalon-sur-Saône où ils pourront avoir un petit appartement. Ils demandent le titre de séjour et obtiennent le statut de réfugiés politiques.
Dès leur arrivée à Chalon, Mohammad cherche des structures pour apprendre le français « Deux fois par semaine, j’avais des cours avec Anna au CICFM. Ma plus jeune fille m’accompagnait parfois dans la poussette. » Son épouse, elle, suivait des cours à l’association Le Pont.
La motivation et l’engagement de Mohammad font qu’il progresse très rapidement « Ces cours de français m’ont permis d’avoir le niveau suffisant pour m’inscrire à l’Université de Bourgogne où j’ai appris le français pendant deux semestres. Puis j’ai passé un examen pour rejoindre le Master Communication Numérique des Organisations ». Depuis cette rentrée, Mohammad a intégré ce Master. « Après ces deux ans, j’espère trouver un travail dans le digital » .

Mohammad et ses confrères devant le parlement afghan, à la sortie d'une session parlementaire.
L’éducation : pilier de la vie de Mohammad
Dans son histoire, l’éducation est quelque chose de très important pour Mohammad. « L’éducation a pour moi un sens particulier. Je suis le premier dans ma famille à avoir étudié dans une école publique. Mes autres frères et sœurs ont eu une éducation religieuse. Pour mes enfants, je dois être un parent éduqué. » Il poursuit « Mais il y a beaucoup de risques à étudier en Afghanistan. Il y a beaucoup d’explosions dans les écoles et les universités ». Elles sont la cible des régimes terroristes. « En France, il n’y a pas de questions de sécurité. En Afghanistan, quand on sort de la maison, on n’a aucune garantie qu’on va rentrer sain et sauf ». Il poursuit : « Malgré les défis, j’ai beaucoup étudié en Afghanistan. Et pour moi, c'est important de suivre ce chemin, je suis content de pouvoir continuer mes études ici. »
Mohammad est aussi heureux que ses enfants puissent étudier en France. Les enfants allophones (dont la langue maternelle est une langue étrangère) sont scolarisés « normalement » et bénéficient d’une classe détachée pour apprendre le français, appelée UPE2A (Unité Pédagogique pour Élèves Allophones Arrivants). « Mon fils aime beaucoup sa maîtresse. Ça le motive pour aller à l’école et il a obtenu une très bonne note en français. »
Concernant le système scolaire, il nous confie avec un léger sourire « Nous avons eu hier une réunion avec le maître pour mon fils et il y a beaucoup de choses à apprendre. Les enfants sont plus occupés ici qu’en Afghanistan. ».
À la maison : le pont des cultures
À la maison, Mohammad et sa famille construisent un nouvel équilibre entre les cultures « Parfois on parle en persan, parfois en français. Quand ils auront grandi, je vais enseigner la langue persan à mes enfants. Parce que c’est une langue très riche. J’aime cette langue. Mais pour le moment ils doivent maîtriser en priorité le français pour ne pas avoir de difficultés à l’école. » Mohammad nous précise que le persan est une langue commune à l’Iran, Le Tadjikistan et l’Afghanistan.
Dans leurs assiettes, ils gardent plutôt les traditions de la cuisine afghane. « Au début, les enfants ne mangeaient pas les repas déjà préparés, industriels. On n’en avait pas en Afghanistan. »
Mais de la cuisine française, il y a une chose qu’ils aiment particulièrement. Ne se rappelant pas du nom, Mohammad nous donne quelques indices : « Il y a un petit truc dedans, c’est sucré, c’est très célèbre vers le Nouvel An » C’est Anna qui a trouvé, et quand elle a prononcé le mot magique « La galette des rois ? », les yeux de Mohammad se sont illuminés « C’est ça ! La galette des rois. Nous aimons beaucoup. Toute la famille. »
Avec sa famille restée en Afghanistan, Mohammad garde contact. Il a trois frères et trois sœurs. La plupart sont encore là-bas, sauf sa sœur, journaliste réfugiée en Allemagne. « Ma mère nous appelle en vidéo, au moins une fois par semaine. Les enfants lui manquent. »
Comme un enfant
Pour conclure, je demande à Mohammad s’il veut ajouter quelque chose sur son parcours. « Ce que je voudrais dire, c’est qu’après la terrible chute de Kaboul, je suis vraiment content et je remercie la France de nous avoir accueillis. À ce moment-là, j’ai cru que c’était la fin de ma vie ou que j’allais avoir une vie terrible. Mais grâce à la France maintenant, je continue ma vie, mes enfants peuvent étudier. »
Il termine, les yeux embrumés : « Tout ça. C’est quelque chose que je n’aurais jamais imaginé vivre. Je ne m’attendais pas à ce que ma vie prenne ce chemin. La vie ici ce n’est pas facile, il faut tout apprendre. En Afghanistan, j’ai travaillé, j’avais réussi et ici, je dois tout réapprendre, tout refaire, les études. Comme un enfant. C’est pas facile. »
De Kaboul à Chalon puis Dijon, Mohammad n’a cessé d’avancer sur son chemin avec le même courage et la détermination qui l’ont guidé depuis ses premiers reportages en Afghanistan. La France est devenue un nouveau chapitre de sa vie, un lieu où sa famille et ses enfants peuvent grandir en sécurité et où il peut envisager l’avenir, non sans difficultés, mais avec l’espoir de se reconstruire.
Nous quittons le café, Mohammad reprend son vélo bleu ciel direction Dijon où nous lui souhaitons beaucoup de soleil et de réussite dans ses études, ainsi qu'à toute sa famille.
Merci Mohammad pour ton témoignage.
Par Manon VINCENT - Pour la revue Voix Du Monde, réalisée avec l'association du CICFM. Découvrez l'intégralité de la revue : Voix Du Monde